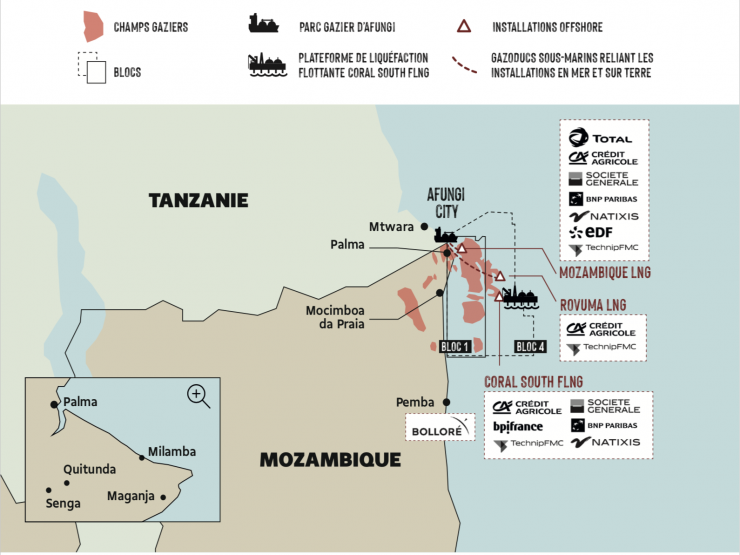« Rendre à la France son indépendance sanitaire » ? Le vœu pieux de Macron sonne bien faux alors que le gouvernement semble sourd aux appels de salariés et d’élus à sauver trois entreprises médico-pharmaceutiques dans la tourmente. Les députés LREM viennent également de refuser la création d’un pôle public du médicament.
Après avoir produit plus de 40 000 sondes de réanimation par jour pour les hôpitaux français pendant toute la crise sanitaire, sept jours sur sept, 60 salariés de l’entreprise Péters Surgical de Bobigny (Seine-Saint-Denis) attendent désormais avec angoisse leur notification de licenciement. Celle-ci devrait leur parvenir d’ici fin juin. La direction ne compte garder sur le site de Seine-Saint-Denis que les services administratifs et de recherche et développement. Leur production de « sondes de Motin », une sonde d’aspiration si précieuses pour intuber les malades du Covid-19 tout en évitant de contaminer les soignants, sera sous-traitée en Inde.
En Auvergne-Rhône-Alpes, deux autres sites industriels du secteur médical sont dans la tourmente. Famar, façonne de nombreux médicaments, dont la Nivaquine, un antipaludique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Le laboratoire, qui travaille pour le compte de grands groupes pharmaceutiques comme Sanofi, est en redressement judiciaire. Trois repreneurs doivent être auditionnés mi-juin, chacun prévoyant de supprimer au moins la moitié des 240 emplois du site de production en banlieue lyonnaise (Saint-Genis-Laval), qui fabrique de nombreux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur. Chez Luxfer, dans le Puy-de-Dôme, aucune bouteille d’oxygène à usage médical ne sort plus de l’usine depuis le printemps 2019. La direction du groupe britannique refuse de céder le site à un repreneur, malgré de nombreuses offres et la proposition des salariés de constituer une société coopérative (lire notre article : Oxygène médical : les ouvriers de l’usine Luxfer appellent à une réouverture d’urgence).
Des entreprises non stratégiques pour le gouvernement
« Les Français pensaient avoir le meilleur système de santé au monde. Après l’épidémie du Covid-19, ils se rendent compte que le pays est dans un état de dépendance sanitaire totale. Nous ne sommes même pas capables de produire du Doliprane sur notre sol », s’emporte Martial Bourquin. L’ancien sénateur PS du Doubs (il vient de démissionner pour se consacrer à la mairie d’Audincourt) est à l’origine d’une proposition de loi visant à nationaliser Péters Surgical, Famar et Luxfer, déposée le 19 mai dernier. À l’Assemblée nationale, des députés socialistes et insoumis ont déjà fait des propositions en ce sens. La secrétaire d’État à l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, leur a d’ores et déjà opposé une fin de non recevoir lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative.
Je lis, j’aime, je vous soutiens
Pour rester en accès libre, Basta ! a besoin de vous, lecteurs !
Soutenez l’indépendance de Basta! en faisant un don.
Selon elle, il s’agirait d’entreprises « non stratégiques ». « Il y en a d’autres qui produisent plus ou moins ce que fait Famar », dit-elle au sujet du laboratoire pharmaceutique lyonnais. Quant aux bouteilles de transport d’oxygène Luxfer, « on peut s’en fournir au Royaume-Uni ». « Cela fait vingt ans que l’on nous ressort le même discours sur des entreprises soi-disant non-stratégiques, donc pas si importantes à sauver. Et aujourd’hui on se retrouve à ne plus pouvoir produire de molécules essentielles, à manquer de masques. En cas de crise, comme celle que l’on a connue, les frontières se ferment. Il devient alors nécessaire d’avoir une production nationale de matériel médical indispensable », rétorque Martial Bourquin.
Les services de réanimation devront s’approvisionner en Inde plutôt qu’en Seine-Saint-Denis
Non stratégiques vraiment ? Si l’activité de ces entreprises quitte le sol national, plusieurs équipements hospitaliers et médicaments ne seront plus du tout fabriqués en France. Famar est actuellement le dernier producteur mondial de Notezine, un antiparasitaire utilisé contre les filarioses lymphatiques et classé comme d’intérêt thérapeutique majeur par l’OMS. Ce médicament est malheureusement peu rentable pour Sanofi, principal client du façonnier lyonnais. Une fois les lignes de production fermées chez Péters Surgical, les services de réanimation devront s’approvisionner en sondes de Motin en Inde plutôt qu’en Seine-Saint-Denis.
Quant au site Luxfer de Gerzat, il était jusqu’à sa fermeture en 2019 le dernier producteur de bouteilles d’oxygène en aluminium en France. « Ils détiennent le monopole sur les bouteilles ultra-légères que nous fabriquons à Gerzat. En fermant notre site, la direction force le marché à se tourner vers du matériel de gamme produit dans ses usines britanniques Ils refusent de vendre l’usine pour ne pas avoir de concurrent sur ce marché et pour pouvoir continuer à fixer les prix à leur guise », estime Axel Peronczyk, délégué syndical CGT chez Luxfer.
Les promesses d’Emmanuel Macron de rendre à la France son indépendance sanitaire semblent bien creuses face à la détresse des salariés de ces trois entreprises : sur ces sites le risque de démantèlement de l’outil industriel et les menaces sur l’emploi datent de bien avant la crise sanitaire. Avec les dispositions juridiques de l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement avait la possibilité de réquisitionner des outils de production, ce qui aurait pu permettre de sauver les emplois chez Luxfer, Famar et Péters Surgical. Il n’en a rien fait.
Des fonds d’investissement aux manettes
« Avec la crise du Covid-19, les appels politiques à la nationalisation se multiplient mais de notre côté, nous n’avons jamais eu un début de discussion avec le gouvernement. Et ce n’est pas faute d’avoir interpellé les ministères de la Santé et de l’Industrie à plusieurs reprises sur le risque de désindustrialisation », explique Yannig Donius, délégué CGT chez Famar. Les appels d’Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis à nationaliser Péters Surgical sont également restés lettre morte. « L’épidémie serait arrivée en juillet, il aurait manqué les 40 000 sondes de réanimation qu’ils produisent quotidiennement, rappelait-il en avril dernier en commission parlementaire. On entend le Président et le ministre de l’Économie parler de relocalisations et de réquisitions mais le problème c’est que l’on n’en voit pas beaucoup ». Même déception pour André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, à qui Bruno Le Maire a affirmé que l’État n’entrerait pas au capital de Luxfer.
En pleine épidémie, Macron avait aussi fait savoir qu’il n’entendait plus laisser « notre capacité à soigner aux lois du marchés ». Chez Famar et Péters Surgical, deux sociétés détenues par des fonds d’investissement, c’est pourtant bien ce qu’il est en train de se passer. Le façonnier de médicaments lyonnais, vendu par Sanofi à un groupe grec de sous-traitance pharmaceutique (Marinopoulos), a fini par tomber dans l’escarcelle de KKR, un fonds d’investissement américain spécialisé dans le rachat d’entreprises par endettement massif, qui a annulé un plan d’investissement de 20 millions d’euros sur le site de Saint-Genis-Laval en 2018.
« Dès lors, c’est la spirale du déclin pour ces sous-traitants. Face à la dégradation de l’outil de production faute d’investissements, les grands laboratoires réduisent peu à peu leurs commandes et vont voir ailleurs. La plupart des façonniers français sont dans des situations similaires de grande fragilité financière. Le gouvernement nous parle d’indépendance sanitaire. Avec les investissements publics nécessaires, Famar pourrait faire partie de la solution », analyse Thierry Bodin, coauteur de Sanofi Big Pharma [1].
Des suppressions d’emplois malgré de généreux dividendes et des bénéfices
Péters Surgical, détenu par le fonds d’investissement français Eurazeo, sous-traite depuis 2017 la production de sondes de Motin vers la Thaïlande et l’Inde, tout en distribuant de généreux dividendes à ses actionnaires, comme l’a révélé Médiapart : 2,5 millions chaque année depuis 2017, pour un résultat net de 5,8 millions d’euros en 2018. C’est dans ce contexte que la direction du site de Bobigny annonce, l’année suivante, son plan social et la suppression de toutes les lignes de production en Seine-Saint-Denis. Pour expliquer les licenciements, la direction invoque de nouvelles normes sanitaires européennes engendrant des surcoûts intenables. « Nationaliser des entreprises en bonne santé financière comme la nôtre n’est malheureusement pas dans la logique du gouvernement néolibéral actuel », regrette Julien Faidherbe, ingénieur d’études et délégué syndical CGT chez Péters Surgical Bobigny.
Luxfer dégageait également des bénéfices au moment de sa fermeture : plus d’un million d’euros de résultat net d’exploitation en 2018. Une situation financière qui ne « prouvait pas la nécessité de fermer le site pour assurer la survie du groupe », affirme l’inspection du travail dans des documents que Basta ! a pu se procurer. La DIRECCTE [2] y estime que le rapatriement de la production de bouteilles d’oxygène médical au Royaume-Uni résulte plutôt « d’une stratégie axée sur la réduction des coûts et la maximisation des profits ». Les licenciements de certains salariés pour motif économique avaient alors été retoqués par les services régionaux de l’État avant d’être finalement validés en plus haut lieu, par le ministère du Travail.
« Le décrochage de l’industrie française à l’origine de la perte d’indépendance sanitaire »
« Notre secteur suit un mouvement similaire à celui de l’industrie pharmaceutique qui délocalise une partie de sa production en Asie. L’épidémie de Covid-19 a bien montré les limites de ce système : une difficulté à augmenter les volumes d’importation en peu de temps, les problèmes de logistique et d’acheminement. En période de forte activité, expédier des sondes aux hôpitaux français depuis Bobigny, c’est bien plus gérable », poursuit Julien Faidherbe. La sous-traitance des sondes de réanimation, comme celle des bouteilles d’oxygène de Luxfer au Royaume-Uni, ne risque certainement pas de renforcer l’indépendance sanitaire française. La désindustrialisation et la concentration de la production aux mains de quelques géants du secteur médical mettent en péril l’approvisionnement du système médical français en matériel essentiel.